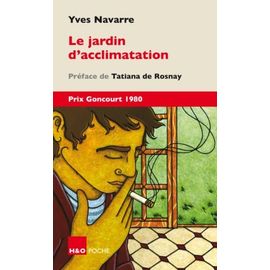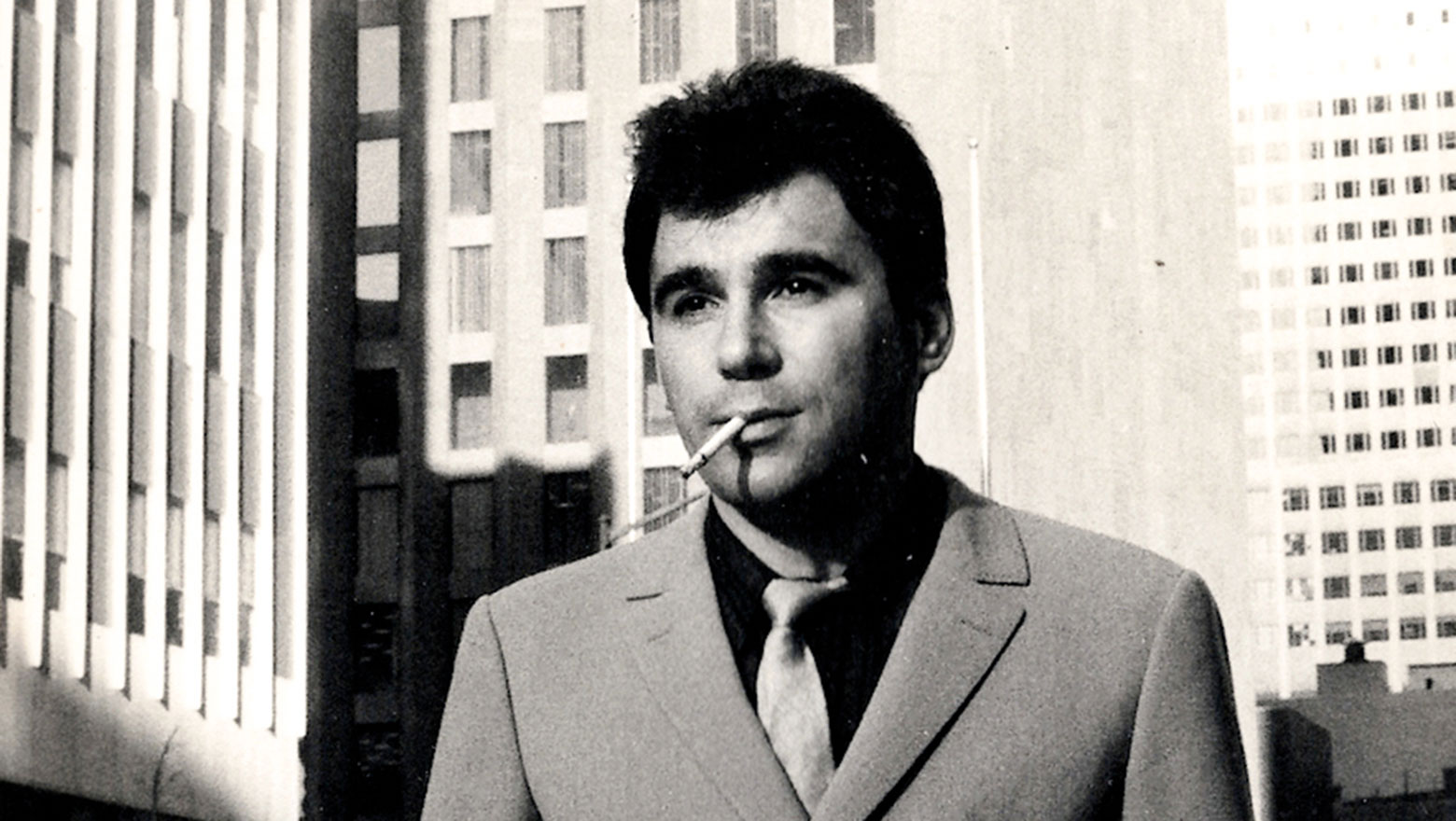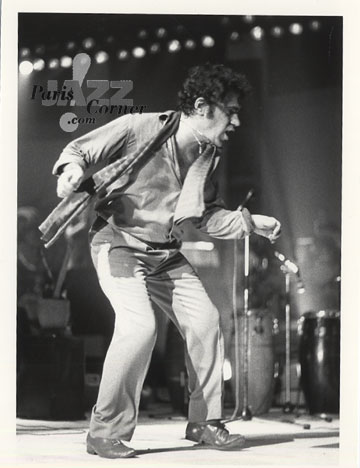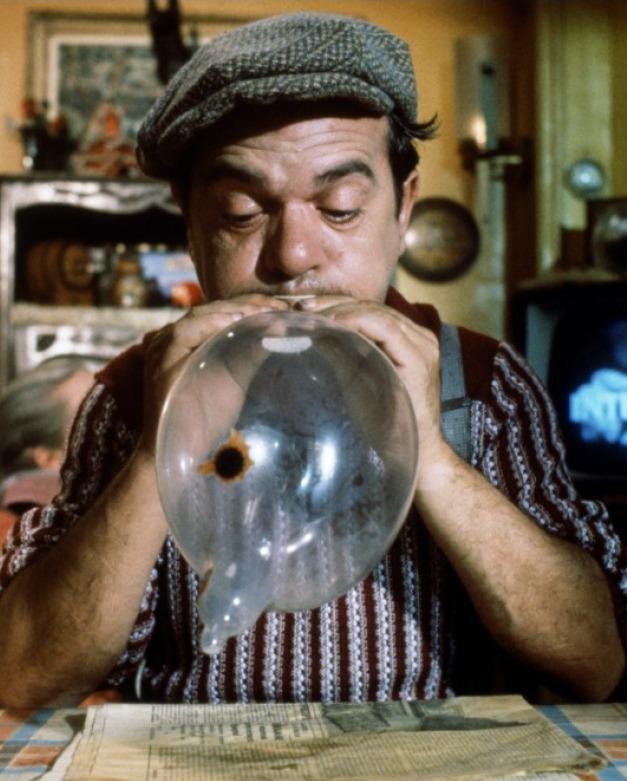Origines et formation : une double culture au service de l’écriture
Née le 21 mai 1961 à Perpignan, dans le quartier populaire de Saint-Jacques, Hélène Legrais est le fruit d’un métissage culturel : bretonne par son père et catalane par sa mère. Ce double héritage nourrit son imaginaire, mêlant la rigueur celtique à la passion méditerranéenne. Dès l’enfance, elle écrit des poèmes et des pièces de théâtre pour ses sœurs, développant ainsi un goût précoce pour la narration.
Après des études d’histoire, elle intègre l’École Supérieure de Journalisme de Lille, dont elle sort major de la 58e promotion en 1984. Cette formation lui ouvre les portes de la radio nationale.
Une carrière journalistique marquée par l’innovation
Hélène Legrais débute à France Inter avant de rejoindre Europe 1 en 1986, où elle reste quatorze ans. Elle y occupe divers postes, du service des sports à la coordination de l’information, en passant par la création du premier site d’information en continu « Europe Info ». En 2000, elle quitte Paris pour retourner en Catalogne et se consacrer à l’écriture.
Une romancière engagée pour la mémoire catalane
Son premier roman, La Damoiselle d’Aguilar, paraît en 1996. Depuis, elle publie régulièrement des œuvres. Ces dernières mettent en lumière des épisodes méconnus de l’histoire catalane. C’est celle de la grève des transbordeuses d’oranges à Cerbère en 1906 (La Transbordeuse d’oranges). Il y a l’engagement d’Élisabeth Eidenbenz à la maternité suisse d’Elne (Les Enfants d’Élisabeth), ou encore la saga de l’entreprise JOB à Perpignan.
Son vingtième roman, Nous étions trois (2020), s’inspire de son expérience journalistique et des défis rencontrés par les femmes dans ce milieu. En 2023, elle est élevée au rang de Chevalière dans l’Ordre des Arts et Lettres. Son dernier ouvrage, La Ballade d’Amélie (2023), aborde avec sensibilité le thème du burn-out à travers le parcours d’une chanteuse lyrique.
Une pédagogue investie dans la transmission
Parallèlement à son activité littéraire, Hélène Legrais anime des ateliers d’écriture. Elle intervient en milieu scolaire et donne des conférences sur la Catalogne. Elle collabore également au Diplôme Universitaire de Photojournalisme de l’Université de Perpignan, contribuant à la formation des futurs journalistes.
Une voix radiophonique fidèle à ses racines
Depuis son retour en Catalogne, elle est chroniqueuse sur France Bleu Roussillon. Elle partage quotidiennement des anecdotes historiques sur les Pyrénées-Orientales. Cette chronique, diffusée chaque jour sauf le week-end, témoigne de son attachement profond à sa région natale.

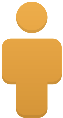
Vous souhaitez en découvrir plus sur les personnages célèbres catalans qui y ont laissé leurs empreintes.